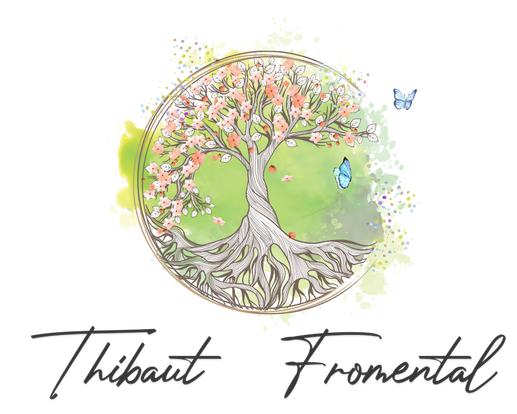Avant toute chose je voulais rappeler que quel que soit notre type d’attachement non sécure, il est possible de se rediriger progressivement vers un attachement sécure en vivant de nouvelles expériences, que ce soit en thérapie, en couple ou en amitié. Le fait de vivre en conscience des expériences de lien sécure de façon répétés et avec des personnes de confiance, permettra progressivement de retrouver une sécurité dans son attachement. Par contre cela peut prendre du temps, parfois plusieurs années selon le degré d’insécurité. En effet, contrairement aux traumas simples qui peuvent être traité en 1 à 3 séances les trauma complexes du développement prennent du temps mais la bonne nouvelle c’est que meme à l’age adulte, le cerveau est plastique et peut se reconfigurer à tout moment de la vie. C’est une bonne nouvelle non ?
Introduction
Aujourd’hui il semble impensable d’accompagner une personne dans ses problématiques de vie sans avoir ces notions d’attachement sécure et insécure. En effet les stratégies que vont utiliser les enfants pour palier aux manquements (trauma de négligences), aux violences ou aux imprévisibilités de leurs figures d’attachement (tantôt affectueux, tantôt absents, tantôt violents, tantôt sous emprise de drogue ou alcool, etc… sans prévisibilité) vont souvent s’installer pour perdurer jusqu’à l’âge adulte, s’il n’y a pas eu de relation sécure et stable entre temps sur laquelle la personne ou l’enfant pourra apprendre à se reposer, à se déposer, à se faire accueillir, à se faire reconnaitre, à se faire comprendre, à se faire aimer, à se faire soutenir, de façon stable et prévisible. John Bowlby, fondateur de la théorie de l’attachement, s’est très tôt intéressé aux conséquences des séparations précoces des enfants avec leurs parents. Pour lui, la théorie de l’attachement consista à dire que l’enfant a besoin, pour se développer normalement sur le plan affectif et social de former une relation affective privilégiée avec au moins un donneur de soins, appelé figurine d’attachement principale. Si les bébés naissent bien avec une prédisposition innée à s’attacher, c’est par la répétition des moments partagés et des soins prodigués qu’un enfant s’attache à un adulte. Deux indices caractérisent une relation d’attachement pour l’enfant : il recherche auprès de sa figure d’attachement (préférentiellement), proximité et sécurité et proteste en cas de séparation subie. Le système d’attachement a pour but de favoriser la proximité de l’enfant avec une ou des figures adultes afin d’obtenir un réconfort lui permettant de retrouver un sentiment de sécurité interne face aux éventuels dangers de l’environnement. Ainsi, toutes les conditions indiquant un danger ou générant du stress pour l’enfant activent ce système que ce soient des facteurs internes, comme la fatigue ou la douleur, ou des facteurs externes, liés à l’environnement (tout stimulus effrayant, par exemple la présence d’étrangers, la solitude, l’absence de la figure d’attachement).
Les comportements d’attachement
Pour obtenir cette proximité, le nourrisson use de divers comportements innés tels que le sourire, les vocalisations, le fait de s’agripper, les pleurs (ces derniers, vécus par le donneur de soins comme désagréables, l’incitent à tenter d’y mettre fin), et, plus tard, la marche. Ces comportements, bien que présents dès la naissance, ne sont pas encore dirigés vers une figure particulière et apparaissent plutôt indifférenciés dans un premier temps pour s’orienter progressivement préférentiellement vers sa mère et les personnes proches. C’est la répétition des expériences de réconfort en situation de détresse qui permet l’émergence progressive d’une meilleure discrimination par l’enfant de ses figures d’attachement.
Le système exploratoire
Quand le système d’attachement n’est plus activé, que l’enfant est rassuré, alors entre en jeu le système exploratoire grâce auquel l’enfant apprend sur son environnement et développe des capacités qui seront importantes pour les stades ultérieurs du développement. Ce système se développe surtout à partir de 7 mois, période qui correspond à la mise en place du système d’attachement et à la constitution de figures d’attachement spécifiques. Avec ses progrès moteurs, sa capacité à se déplacer, l’enfant peut s’éloigner pour explorer et étendre ainsi considérablement son horizon. Il devient dès lors particulièrement actif dans la régulation de la distance avec l’adulte
La figure d’attachement
La figure d’attachement est la personne vers laquelle l’enfant dirige son comportement d’attachement. Est susceptible de devenir une figure d’attachement tout adulte (dans les conditions normales) qui s’engage dans une interaction sociale et durable animée avec le bébé, et qui répondra facilement à ses signaux et à ses approches.
On peut repérer dans le réseau social de l’enfant les figures d’attachement ayant une fonction de caregiver à partir des trois critères suivants : il s’agit d’une personne prenant soin physiquement et émotionnellement de l’enfant, ayant une présence importante et régulière dans sa vie et l’investissant émotionnellement Le plus souvent, la mère devient la figure d’attachement principale parce que c’est celle qui, autour des soins de routine, passe le plus de temps avec le bébé dans les premiers temps Vers 3 ans, L’enfant a beaucoup moins besoin de la réalité d’une proximité que de la conviction de la possibilité d’obtenir l’attention du caregiver. Le développement de son langage lui permet de faire part de ses souhaits et de ses ressentis à ses figures d’attachement. Grâce à sa motricité, il peut réguler de lui-même la distance optimale supportable avec sa figure d’attachement ; le développement de ses capacités cognitives lui permet de s’être construit une représentation mentale de la séparation, qu’il peut mieux tolérer. Il est moins désemparé lors des séparations, et ce d’autant plus qu’il aura négocié et se sera mis d’accord avec sa figure d’attachement sur les conditions de cette séparation et sur les modalités des retrouvailles. On parle de partenariat émergeant. L’enfant est alors prêt pour une nouvelle étape. Ses capacités à tenir compte des attentes et de l’état d’esprit de sa figure d’attachement, à adapter ses comportements en conséquence lui permettent de différer ses demandes et d’adapter des stratégies logiques pour atteindre un objectif. C’est le « partenariat corrigé quant au but », qui prend toute son importance dans les situations clés réveillant l’attachement que sont les séparations et les conflits autour de l’autorité (Mintz, Guédeney, 2009).
Attachement sécure VS Attachement insécure
La principale caractéristique qui différencie un attachement sécure d’un attachement insécure est liée au fait que, dans le premier cas, le parent répond adéquatement aux signaux et aux besoins de l’enfant et ce dernier n’a pas d’effort particulier à faire pour être entendu et objet d’attention, d’affection. Dans le second cas, la réponse est soit inadaptée, soit incohérente, soit absente, ce qui conduit l’enfant à devoir mettre en place des stratégies particulières d’adaptation (soit de type évitant, soit de type anxieux). Dans la première catégorie (attachement insécure ambivalent/ anxieux), les interactions entre la mère et son bébé se passent sans heurts mais sans véritable partage affectif non plus. La mère est jugée intrusive dans le sens où elle impose beaucoup sans tenir compte des envies de son enfant (de faire par lui-même, de décider de ses propres jeux, voire d’être laissé tranquille). Cette volonté de projet éducatif ne respecte pas nécessairement les capacités de l’enfant et conduit celui-ci à se sentir aimé qu’en cas de réussite. Il apparaît néanmoins comme un enfant aimable et éveillé. Dans la deuxième catégorie (attachement insécure évitant), l’enfant maîtrise ses émotions et est très indépendant avec peu d’interactions avec sa mère (surtout pas affectives). Il arrive même que l’enfant se montre plus enjoué avec un inconnu qu’avec sa mère, celle-ci se montrant souvent davantage intéressée par les visiteurs que par son enfant. Quand l’enfant exprime de la détresse ou de la douleur, sa mère détourne son attention. Les parents évitants découragent les tentatives de rapprochement de leur enfant et les parents anxieux découragent les tentatives d’exploration. Dans la troisième catégorie (attachement sécure), les bébés peuvent se montrer très inquiets lors de la situation étrange et pleurer beaucoup. Mais les chercheurs ont remarqué que le niveau de l’hormone de stress (cortisol) augmente peu pendant l’expérience, comme si les pleurs fonctionnaient seulement comme un signal devant assurer le retour de leur mère, et non comme l’expression d’un désespoir profond. Une quatrième catégorie a été ajouté par Mary Main, autre chercheuse en psychologie : l’attachement désorienté/ désorganisé. L’enfant ayant un attachement insécure désorganisé/ désorienté aura un comportement chaotique et instable. L’enfant perd le lien avec ses émotions et sa vie affective. Les spécialistes de l’attachement parle d’“une peur sans solution”. Il n’a pas de stratégie d’attachement repérable. Chez les enfants désorganisés/ désorientés, des ruptures et des incohérences apparaissent dans les stratégies d’attachement : ils sont susceptibles de s’immobiliser comme pétrifiés de peur au moment de rejoindre leur mère, qu’ils tentent parfois d’approcher de biais, ne parvenant pas à maintenir leur attention au point de paraître absents, confus, désorientés. Ils auront d’un côté envie de recevoir l’amour et l’attention de leur figure d’attachement, mais celle ci va aussi leur faire vivre de grandes souffrances (violences physiques, sexuelles, tortures, négligence, parents toxiques, manipulateurs, parents instables psychologiquement, drogues/alcool, etc…)
Les 3 types d’attachement
1. Attachement sécure
L’attachement sécure est corrélé à la sensibilité de la mère ainsi qu’au plaisir que cette dernière prend à s’occuper de son enfant. La relation mère/enfant est fluide et les réactions cohérentes et appropriées de part et d’autre, sans indépendance ou dépendance marquée.
A l’âge de 6 ans, les enfants évalués sécures à 12 mois se montrent peu affectés par la séparation d’une heure avec leurs parents. A leur retour, ils les accueillent calmement mais avec plaisir, les associant volontiers à leur activité en cours.
Ce schéma sécure se maintient au long des années et est associé à une certaine flexibilité attentionnelle et cognitive alternant les points de vue et les centres d’intérêt, sans se mettre sur la défensive systématiquement en cas de contradiction. Les personnes à l’attachement évitant apparaissent comme des personnes calmes, responsables et prévisibles, en apparence agréables à vivre par la transformation de leurs affects en façade positive. Pourtant, ces stratégies résistent plus ou moins bien au stress et l’effondrement peut être brutal et spectaculaire, se traduisant par des colères, des sarcasmes et une prise de distance, voire une décompensation dans la dépression quand les affects douloureux ne peuvent plus être contenus.
2. Attachement évitant
Un attachement évitant est marqué par un évitement par l’enfant de ses états émotionnels qui ne sont pas reconnus et traités en tant que tels par les adultes. L’attachement évitant est caractérisé par un manque d’attention de la mère face à la détresse de son enfant, par des réactions de colère ou des moqueries de la part de la mère. Les enfants à l’attachement évitant inhibent leurs manifestations affectives pour en éviter les conséquences indésirables (les réactions négatives de la figure d’attachement). L’accent est placé sur le raisonnement au détriment des affects. On peut le voir à l’age adulte avec des personnes essentiellement en lien avec leur mental plutôt que leurs intuitons ou ressentis corporels. Les enfants évalués évitants à 12 mois se remarquent dans la situation étrange par leur apparente indifférence à l’absence de leur figure d’attachement puis à son retour, continuant à jouer et explorer comme avant la séparation, même quand ils sont laissés seuls. Tout se passe comme si plus l’insécurité est grande (environnement et personnes inconnus), plus ces enfants adoptent une attitude nonchalante et attentive en même temps pour ne courir aucun risque de rejet de leur mère et s’assurer une proximité minimale en cas de danger extérieur. A l’âge de 6 ans, ces enfants continuent de se montrer évitants lors des retrouvailles avec leur mère. Ils évitent subtilement les conversations par des silences ou des absences de développement sur les sujets abordés (réponses courtes, “je ne sais pas”, “rien”…).
Toutes les études récentes montrent que les personnes à l’attachement évitant, dont l’enfance a été marquée par un manque affectif, sont extrêmement déstabilisées dès qu’on leur parle d’attachement et d’amour…
3. Attachement ambivalent (ou anxieux)
L’attachement ambivalent/anxieux s’illustre par un fonctionnement quasi exclusif sur un mode émotionnel chez l’enfant, là encore engendré par des réactions parentales qui peuvent être opposées telle que l’hypervigilance anxieuse (surprotection) ou au contraire le désintérêt ou la négligence. A force de vivre ce type d’expérience l’enfant/le bébé va créer des stratégies émotionnelles pour se faire entendre et pour palier à sa propre anxiété.
A l’âge de parler, l’enfant anxieux/ambivalent pourra manipuler volontairement l’autre particulièrement en feignant des émotions qui ne sont pas réelles ou en exagérant celles qui le sont. Ces stratégies coercitives de maintien du lien peuvent s’exprimer d’autres manières : opposition, agressivité, mensonges, fausses excuses, séduction, critiques, plaintes…Le tout pour avoir plus de probabilité d’avoir du lien et de l’attention. La séduction alterne avec l’agressivité par manque de confiance en soi et manque de confiance en l’autre. Les personnes à l’attachement anxieux/ambivalent sont marquées quant à elles par l’irrégularité des réactions parentales subies dans l’enfance et qui engendre d’importants sentiments de frustration, de colère et de peur (liés au fait de ne pas être pris en compte, de ne pas être entendu, de risquer d’être abandonné).
Les personnes à l’attachement anxieux/ambivalent ont besoin de l’autre pour exister, même si les relations sont chaotiques (associant agressivité et soumission). A noter qu’il existe de nombreuses personnes qui associent ces réactions en fonction des interlocuteurs et en fonction des circonstances.
Une représentation du monde et des autres négative
Quand les parents ne fournissent pas aux enfants une base sécure vers laquelle se replier à tout moment, en rejetant leurs comportements de rapprochement, en se moquant d’eux, en ne leur prêtant aucune attention ou simplement en n’étant pas présent ni disponible, les enfants sont limités dans leurs explorations qui s’avèrent bien trop dangereuses dans ces conditions. Yvane Wiart prévient :
Ce qui se joue avec le bébé ou le petit enfant risque fort de se reproduire ultérieurement car il est peu fréquent qu’on change d’environnement familial et lorsque les conditions changent, c’est souvent dans des conditions dramatiques. Ainsi, un schéma de ce type aura tendance à se trouver renforcé jour après jour aboutissant à la construction d’une représentation du monde comme un lieu plein d’inconnus et de menaces potentielles, où l’enfant devenu adolescent puis adulte, se sentira incapable d’affronter seul toute nouveauté, où il se dira que les autres ne sont pas fiables, qu’ils ne sont pas disponibles en cas de problème et que de toute façon, il ne mérite pas d’être aidé. En outre, ce qui vaut pour les situations d’exploration de l’environnement physique vaut aussi pour ce qui est de l’environnement psychique, à savoir la connaissance et la compréhension de soi et d’autrui, le droit de poser à ses parents des questions personnelles, d’avoir une réponse authentique, de pouvoir exprimer ses émotions, donner un point de vue.
Type d’attachement et relations amoureuses
Les adultes sécures n’ont aucune difficulté à devenir intimes et à faire confiance à leur partenaire. Ils pensent que l’amour existe et peut être durable. Ils sont en même temps capables de reconnaître et exprimer les affects négatifs engendrés par la relations et d’imaginer des issues positives en cas de conflit. Les adultes ambivalents/anxieux ont des demandes affectives démesurées et leur peur d’être abandonnés les mène à douter de la sincérité de l’amour de l’autre.
Article sur L’évitant en relation amoureuse.
Résumé des différents styles d’attachement
Les styles d’attachement reflètent les prédispositions de l’enfant, son tempérament et la cohérence des réponses parentales en situation de stress. Ces différentes catégories d’attachement sont des stratégies adaptatives sans conséquence psychopathologique. Il est pourtant évident qu’avoir des stratégies attachementales sécures est un facteur de protection contre l’adversité. Ces enfants explorent leur environnement plus librement, ils régulent mieux leurs émotions lors d’événements de vie stressants. Parallèlement, les catégories insécures sont des stratégies adaptatives plus rigides, facteurs de vulnérabilité.
Plus tard, George, Main et Kaplan (1991) décrivent l’attachement désorganisé, lorsque l’enfant n’a plus aucune stratégie pour s’adapter aux situations de stress. Ce style d’attachement est, quant à lui, beaucoup plus fortement corrélé avec la psychopathologie et justifie de développer des interventions thérapeutiques centrées sur cette problématique.
L’attachement de type sécure. Il s’accompagne, chez l’enfant, d’une meilleure estime de soi et de la capacité de faire appel lorsqu’il en a besoin. Il favorise également la capacité d’exploration. L’enfant manifeste une forme de protestation lors des séparations et accueille sa mère avec plaisir, à son retour.
L’attachement de type insécure évitant. L’enfant ne fait pas appel à autrui au fur et à mesure que son stress augmente. Il a tendance à masquer sa détresse émotionnelle, ou à se sentir invulnérable, et à considérer que l’on ne peut pas faire confiance aux autres. Il essaie de garder le contrôle dans les situations de détresse en diminuant la réactivité du système d’attachement et en réduisant ses signaux de détresse en direction des parents.
L’attachement de type insécure ambivalent ou résistant. L’enfant se montre très ambivalent en situation de stress, comme s’il résistait à son besoin d’être réconforté. Il adopte une stratégie d’augmentation de fonctionnement du système d’attachement et d’augmentation des signaux. Il manifeste de la détresse lors de la séparation, un mélange de recherche de contact et de rejet coléreux, des difficultés à être réconforté.
L’attachement désorganisé : il s’agit d’enfants qui, typiquement, se figent lors de la réunion dans une posture évoquant l’appréhension et la confusion. La séquence temporelle, chez ces enfants, donne une impression de désorganisation ; des comportements apparemment opposés sont exprimés simultanément (comme s’approcher avec la tête détournée) ; les mouvements semblent incomplets et l’expression des affects mal dirigée. On parle d’enfants désorientés-désorganisés. Il s’agit, pour beaucoup, d’enfants victimes de maltraitance ou témoins de violence ; c’est-à-dire d’enfants dont les figures d’attachement sont elles-mêmes terrifiées et/ou terrifiantes.
Une reprise de contact avec l’instinct d’attachement
Ainsi, il est possible d’envisager une reprise dans une évolution bloquée :
- soit par une action thérapeutique professionnelle,
- soit par une rencontre avec une personne sécure qui peut parvenir à faire évoluer les modalités d’attachement insécure d’un partenaire,
- soit par une prise de conscience personnelle sur ce qu’il y a de mieux à faire (mais ce cas est extrêmement rare et difficile).
Dans tous les cas, patience et attention sont des prérequis vers une vie plus harmonieuse.
Conclusion
La théorie de l’attachement permet d’étudier la façon dont l’enfant déstabilisé, stressé demande et obtient du réconfort de la part d’un adulte, sa figure d’attachement. Ces interactions précoces vont modeler les représentations concernant l’image de soi d’autrui. C’est donc une théorie du développement psychique dans le cadre des relations interpersonnelles. Les différents styles d’attachement sécure ou insécure doivent être considérés comme des facteurs de protection ou de vulnérabilité qui s’intriquent avec d’autres aspects tels que le tempérament, les conditions et événements de vie.
Si cette théorie n’a pas vocation à expliciter toute la psychopathologie, elle permet néanmoins d’aborder d’un autre point de vue de nombreuses situations cliniques, tels que les placements, les conséquences des divorces, les hospitalisations au long cours…
Une des fonctions de l’attachement est de permettre de se sentir en sécurité, de façon à pouvoir partir à la découverte de ce qui nous entoure. Cela est très important pour le développement intellectuel et moteur du bébé, mais demeure une constante dans la vie adulte, sous forme de curiosité intellectuelle, curiosité relationnelle et absence de crainte face à la nouveauté ou à l’inconnu. – Yvane Wiart
| 🧭 Aspect | 💚 Sécure | ❄️ Évitant | 🔥 Anxieux | ⚡ Désorganisé |
|---|---|---|---|---|
| Relation à l’intimité | À l’aise avec la proximité et l’autonomie | Inconfort avec la proximité, besoin d’espace | Recherche beaucoup de proximité, peur d’être abandonné | Désir d’intimité mais peur du rejet ou de la trahison |
| Gestion des émotions | Sait exprimer et réguler ses émotions | Les minimise ou les évite | Les amplifie, difficulté à les apaiser seul | Émotions intenses et contradictoires |
| Vision de soi | Se sent digne d’amour | Se perçoit comme fort, autosuffisant | Se sent souvent insuffisant, a besoin d’être rassuré | Image de soi instable ou confuse |
| Vision des autres | Les voit comme fiables et disponibles | Les voit comme envahissants ou peu fiables | Les voit comme essentiels mais potentiellement instables | Les voit comme à la fois attirants et dangereux |
| Comportement en couple | Communique ouvertement, gère les conflits avec calme | Prend ses distances, fuit les discussions émotionnelles | Recherche la fusion, peut devenir dépendant | Alterne entre rapprochement et rejet, comportement imprévisible |
| Réaction au stress relationnel | Dialogue et confiance | Fermeture, retrait, froideur | Anxiété, colère, supplication | Panique, confusion, comportements contradictoires |
| Origine probable dans l’enfance | Parents disponibles et bienveillants | Parents distants, exigeants ou peu démonstratifs | Parents inconsistants (présents parfois, absents parfois) | Parents imprévisibles, parfois maltraitants ou effrayants |
| Besoins principaux | Sécurité, authenticité | Liberté, indépendance | Réassurance, attention | Stabilité, sécurité émotionnelle |
| Croissance possible | Maintenir un équilibre sain | Apprendre à s’ouvrir émotionnellement | Apprendre à s’aut apaiser | Travailler la sécurité intérieure et la confiance |